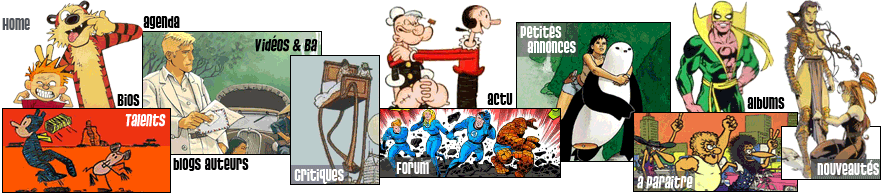Maria et moi par Philippe Belhache 





Les tabous tombent petit à petit. Plusieurs récits touchant aux troubles mentaux chez l'enfant ont vu le jour ces derniers mois, souvent justes, fictions ou (auto)biographies. « Maria et moi », qui appartient à ce deuxième ensemble, sort naturellement du lot. Ce récit tendre et émouvant, parfois drôle, est la chronique d’un été passé par le dessinateur espagnol Miguel Gallardo, l’un des chefs de file de la bande dessinée underground espagnole, et sa fille, Maria, 12 ans, dans un village de vacances aux Canaries. Maria est autiste. Son comportement, ses manies, son humour particulier focalise sur eux le regard des autres. Miguel Gallardo en a pris son parti, le sourire de sa fille, sa joie, étant ce qui compte le plus pour lui. L’auteur n’est cependant jamais loin. L’homme note au jour le jour les progrès de Maria, grands ou petits, victoires remportées au quotidien. Il note aussi les comportements obsessionnels de sa fille, tous ces gestes répétitifs, ces rituels qu’elle s’impose pour calmer son anxiété et profiter de la vie. Maria égrène le sable dans ses doigts pendant des heures, recense à l’infini les noms de ses camarades de classes, amis ou parents, qu’elle mémorise avec une acuité surprenante, relit sans cesse les cartes que lui a dessinées son père pour lui permettre de se repérer au quotidien… Elle évolue avec ses propres codes dans un monde qui ne la comprend pas. L’album, qui alterne de longues plages de texte, des illustrations et des planches classiques, surprend par sa sérénité, son absence de pathos. Miguel Gallardo n’est pas là pour pleurer, mais pour dire l'amour qu'il porte à sa fille. Et donner à réfléchir aux autres. « Maria et moi » n’est pas seulement un témoignage touchant et joyeux. Il se fait également didactique, donnant à voir et à comprendre, de manière simple et sensible, la réalité de ces troubles que chacun pense connaître sans jamais réellement en soupçonner les implications. Cela rend l’ouvrage tout simplement précieux.